
A titre de rappel, de nombreux scientifiques, en particulier les climatologues, mettent en évidence le lien entre la croissance économique sans limite et la menace importante qui pèse sur l’équilibre climatique mondial. En effet, ils démontrent que la croissance économique continue est basée sur les énergies fossiles émettant de plus en plus de gaz à effet de serre, et que ces émissions menacent le climat. De plus, les perturbations climatiques sont déjà visibles et attestées aujourd’hui dans différentes parties du monde.
Malgré ce constat, nous pourrions penser que le développement économique de notre région et notre richesse matérielle personnelle sont le résultat automatique du salut de notre âme et de l’assurance de la vie éternelle. Penser que la richesse matérielle, une santé parfaite et la vie éternelle sont une bénédiction de Dieu et une récompense directe et automatique de la rédemption des péchés n’est pas ce que la Bible nous enseigne.
Anne-Catherine Piguet, théologienne protestante, a écrit un article complet, critique et édifiant au sujet de la théologie de la prospérité1. Selon elle, cette théorie affirme que si un croyant est malade et pauvre, c’est de sa faute parce qu’il est dans le péché et dans une nature satanique. Et s’il a la foi, il est automatiquement en bonne santé, sauvé et riche matériellement. Cette théorie affirme aussi que Jésus-Christ lui-même a eu une nature satanique lorsqu’il a été crucifié sur la croix jusqu’à sa résurrection.
La majorité des théologiens rejettent cette vision spirituelle. En effet, la Bible n’affirme pas un lien automatique entre le salut de l’âme, la santé et la richesse matérielle. De même, il n’y a pas de lien automatique non plus entre le péché qui entraînerait directement la pauvreté, la maladie et une nature satanique de l’homme.
Le danger de cette vision est d’affirmer que la pauvreté est une question de mauvaise moralité et que les pauvres sont donc directement responsables de leur misère. En conséquence, ils ne méritent ni aide financière, ni compassion, puisqu’ils sont eux-mêmes coupables de leur situation. Le deuxième danger de cette vision est que la richesse matérielle et la liberté de la recherche du profit infini sont considérés comme une bénédiction de Dieu automatiquement attribué au pécheur repenti de sa nature satanique. Cette affirmation bloque de facto de nombreuses solutions constructives à la crise climatique. En effet, elle va directement à l’encontre de la remise en question de la société de consommation de masse dans laquelle nous vivons aujourd’hui, de sa croissance sans limite et de la pollution qui en découle en termes de gaz à effet de serre.
Source : Marc Roethlisberger et Steve Tanner, FAQ, Déclaration Urgence Climat Suisse.
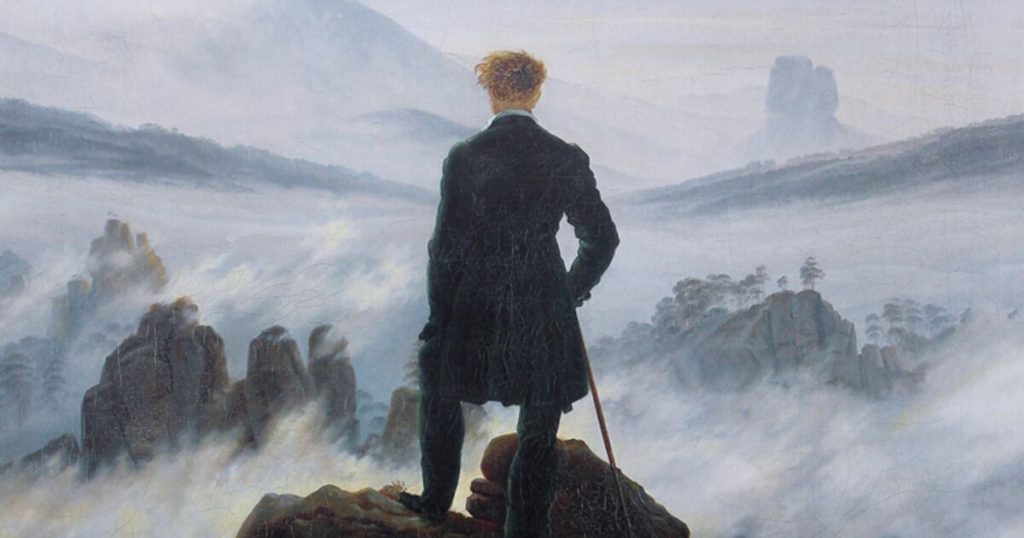
Si vous souhaitez empêcher la crise écologique d’arriver, c’est peine perdue, elle est déjà là. Cependant, vous pouvez espérer que ses conséquences ne soient pas aussi désastreuses qu’en ne faisant rien.
Bien que chacun puisse contribuer en consommant mieux et moins1, l’enjeu est avant tout collectif car c’est bien la société qui doit changer sa manière de fonctionner2. Selon vos appétences, vous pouvez vous engager en politique3, dans une association, dans votre église ou au sein de votre famille, pour qu’on puisse être mieux préparé à endurer les conséquences de la crise, mais également pour limiter la casse autant que possible.
Seulement, il faut déjà bien comprendre cette crise, pour en juger les solutions selon votre contexte. En vous informant, vous risquez de désespérer, car la plupart des solutions sont partielles, il n’y a rien d’absolu, mais il faut persévérer.
Face à nos capacités limitées, il est préférable d’agir par amour que par angoisse, car nous n’arriverons pas à chasser les raisons de nos peurs en se « donnant à fond ».
Nous vous encourageons donc à redoubler de foi et d’espérance en recherchant cela auprès de Dieu dans la prière et la médiation de la Bible, la littérature prophétique vous semblera bien actuelle et ses promesses de restauration d’autant plus savoureuses. Vous pouvez également jeûner plusieurs fois par semaine comme avaient l’habitude les premiers chrétiens4, en demandant à Dieu d’intervenir et de mettre de la lumière dans notre histoire qui s’assombrit.
A Rocha propose des formations et incite les églises à s’emparer de ce sujet, afin que chacun puisse, grâce à Dieu, exprimer son amour dans une direction vrai malgré l’inconfort et la souffrance que cela peut impliquer.
Inspiré de https://france.arocha.org/fr/news/que-faire-concretement-face-a-la-crise-ecologique/

A titre de rappel, l’augmentation moyenne de la température mondiale due principalement aux activités humaines a commencé au début de la révolution industrielle, soit vers 1800. Toutefois, l’existence du système économique et politique qui est à l’origine de ce phénomène remonte à plus loin dans le temps. Certains auteurs datent le début de ce système au 15ème siècle avec la Renaissance en Italie du nord et l’invention de la comptabilité, et en Allemagne avec l’invention de l’imprimerie et la naissance du protestantisme. D’autres citent le Bas Moyen-Âge avec un commerce florissant en Méditerranée grâce aux Croisades et au grand développement des ordres monastiques, source de développement économique.
Le développement économique a assurément des côtés positifs et négatifs et l’influence de la spiritualité chrétienne sur celui-ci est certainement importante et complexe. Dans Genèse 1.28, nous pouvons lire cette bénédiction et exhortation de Dieu envers les hommes : « Dieu les bénit en disant : – Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes ». De nombreux auteurs, dont des théologiens, ont souligné que les versets de la Genèse qui « exhortent l’homme à dominer le monde et tous les animaux de la terre » a eu une grande influence sur la pensée occidentale et son système économique. Ils ajoutent également que ces versets ont été mal compris et mal interprétés, car la notion de responsabilité envers la Création a été oubliée ou, en tout cas, mise au second rang des priorités.
Nous considérons donc que la spiritualité chrétienne a eu une influence historique importante sur le système économique dans lequel nous vivons aujourd’hui, y compris dans ses effets négatifs, à cause d’une mauvaise interprétation de certains passages bibliques et de l’oubli d’autres textes dans lesquels Dieu donne une responsabilité importante à l’homme envers la Création et exprime son amour pour tout ce qu’il a créé. Les fondements théologiques exposés dans le texte de la déclaration d’urgence climat suisse passent en revue ces passages bibliques pour une approche plus responsable et équilibrée de l’être humain en regard de la crise climatique actuelle.
Source : Marc Roethlisberger et Steve Tanner, FAQ, Déclaration Urgence Climat Suisse.
De nombreuses personnes ont vécu dans le déni de la crise climatique pendant des années jusqu’à ce que tout à coup, il y ait une prise de conscience de la réalité. Toutefois, une partie de ces personnes sont tombées dans le défaitisme et le pessimisme : « Il est maintenant trop tard », « avec toutes les bêtises que l’homme a faites, c’est tant mieux s’il disparaît de la surface de la terre », « j’attends la fin, on ne peut de toute façon plus rien faire… », etc. Nous pensons que le défaitisme et le pessimisme ne sont pas des attitudes encouragées par Dieu. Différents héros de la Bible nous ont montré un courage extraordinaire, un optimisme rayonnant et une confiance en Dieu sans faille face à leurs défis. Jésus-Christ est venu nous apporter l’espérance, le salut et la joie dans une vie pleine de sa présence bienveillante. Dieu a un plan pour nous et pour le monde. Il nous a en même temps donné des responsabilités qui sont également valables pour le défi du climat.
Source : adapté de Marc Roethlisberger et Steve Tanner, FAQ, Déclaration Urgence Climat Suisse.

Il est légitime de se sentir submergé par l’ampleur de la crise écologique, mais voici quelques idées qui pourraient vous aider :
- Pensez local ! Votre responsabilité n’est pas de changer le monde à vous tout seul, mais de « devenir le changement que vous désirez voir dans le monde » (Gandhi). En d’autres termes, notre appel ne consiste pas à avoir du succès, mais plutôt à obéir à ce que Dieu nous demande. Assurons-nous de changer ce que nous pouvons et laissons Dieu s’occuper de la « grande image ».
- Prenez un peu de recul ! « Le changement climatique n’est pas un énorme problème insoluble, mais des millions de petits problèmes qui peuvent être résolus(3)». En d’autres termes, si nous répartissons les choses dans les décisions quotidiennes que nous prenons tous, nous pourrons ensemble faire une grande différence. Comme le dit la devinette : « Comment mange-t-on un éléphant ? Une bouchée à la fois ! »
- Prenez courage ! Les mouvements qui vont changer le monde peuvent avoir de tout petits commencements apparemment insignifiants. Pensez à William Wilberforce et à l’abolition de l’esclavage(4), à Gandhi et au mouvement Quit India (Quittez l’Inde), ou à ce prédicateur itinérant du Moyen-Orient qui, il y a 2 000 ans, est mort comme un « raté » et a transformé le monde.
(3) Nick Spencer et Robert White, Christianity, Climate Change and Sustainable Living, SPCK, 2007, p. 62.
(4) Gabrielle Desarzens (et alii), Figures évangéliques de résistance, Dossier Vivre n° 35, Saint-Prex, Je Sème, 2013, p. 115)
(question extraite du livre de Dave Bookless, Dieu, l’écologie et moi, Appendice 1, « les pourquoi ? de la planète »)