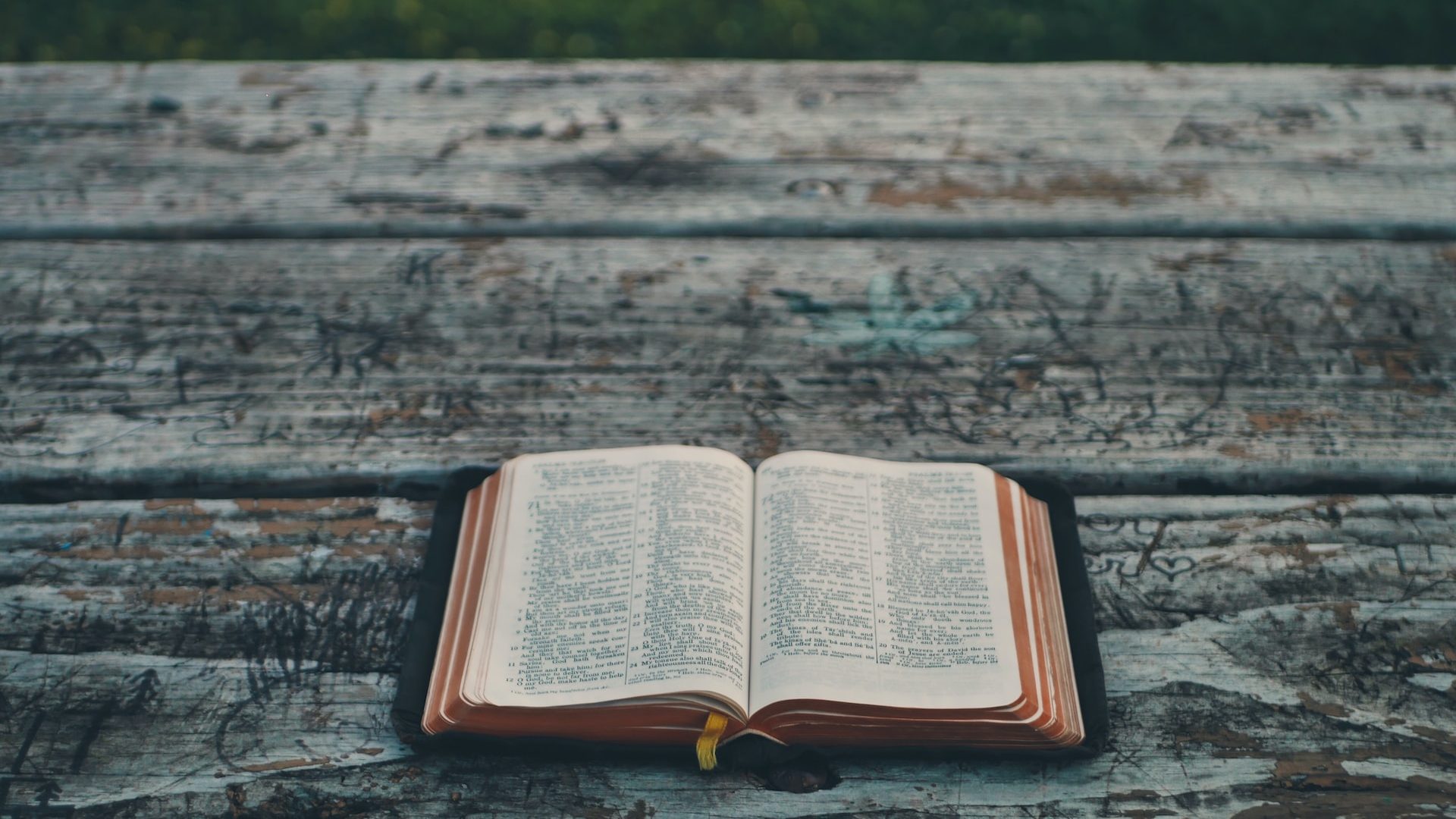
Ces deux versets font référence à ce que nous appelons « la chute » de l’homme, ce moment où le péché, le mal et la mort sont apparus dans le monde suite au péché d’Adam et Eve. La question que nous pouvons nous poser est la suivante : Qui provoque cette malédiction et cette inconsistance (en grec, vide, néant) ? Qui est celui qui maudit et qui soumet ainsi la création à l’inconsistance ? L’homme ou Dieu ?
Si nous prenons en compte l’origine de la malédiction, nous pouvons remarquer qu’elle fait indéniablement suite à la désobéissance des premiers humains. Ainsi, dans la Genèse, Adam et Eve sont décrits comme ceux qui, trompés par le serpent, ont pris l’initiative de la désobéissance qui touchera la terre et la création entière. Paul exprime la même chose en Romains 5/14-17, désignant Adam comme celui par qui le péché est entré dans le monde. Ainsi, l’homme est en cause dans la malédiction, puisque cette dernière vient de son péché.
Dieu a quelque chose à voir, cependant, dans cette malédiction, dans la mesure où il s’agit de la sanction qu’il a choisie pour l’humain. Si nous lisons bien Genèse 3, nous pouvons remarquer que la sanction de Dieu dit sa sollicitude pour l’humain. Ainsi, Dieu met-il à l’homme des limites, afin qu’il puisse se rendre compte qu’il n’est pas Dieu et se détourner du mensonge du serpent (Genèse 3/4-5) pour pouvoir se tourner vers le vrai Dieu. Sa sollicitude ira si loin qu’en Christ, il acceptera de porter lui-même la malédiction du péché pour nous en libérer (Galates 3/13-14).

Nombreux sont les chrétiens qu’une telle question pourrait choquer ; elle est pourtant posée de plus en plus fréquemment. Après tout (c’est un des arguments), si nous sommes responsables de tous les problèmes, la terre ne s’en tirerait-elle peut-être pas mieux sans nous ? Ne sommes-nous pas juste une « espèce de virus » ?(5) L’évidence de l’impact négatif de l’humanité est aujourd’hui très nette; les chrétiens devraient donc être prudents lorsqu’ils affirment naïvement que l’homme est à l’image de Dieu et que, par conséquent, la planète doit mieux se porter avec nous que sans nous. Nous avons plutôt à nous repentir de notre incapacité à refléter l’image de Dieu dans notre manière de traiter la terre, et à démontrer par nos actions que nous pouvons faire une différence positive. Si nous estimons que Dieu nous a confié la création, nous devons faire preuve de davantage de prudence envers elle.
(5) « Notre comportement ‘viral’ pourrait être fatal à la fois à la biosphère et à nous-mêmes. » Paul Watson in The Beginning of the End for Life as We Know it on Planet Earth ? Voir : https://www.seashepherd.org.uk/news-and-commentary/commentary/the-beginning-of-the-end-for-life-as-we-know-it-on-planet-earth.html .
(question extraite du livre de Dave Bookless, Dieu, l’écologie et moi, Appendice 1, « les pourquoi ? de la planète »)

Pour les croyants en Dieu, la vie est un équilibre entre la part qui nous incombe, et la part qui échappe à notre contrôle. Cette réalité est présente dans les Évangiles au travers de plusieurs paraboles (les Talents, les deux maisons, les dix Vierges, etc.) qui mettent en avant la responsabilité individuelle pour sa vie physique et spirituelle. Dieu donne à chacun intelligence, créativité et capacités pour vivre chaque jour et progresser, sans pour autant nous priver de sa présence et son conseil Divin.
Le climat n’échappe pas à ce principe. La Terre est une grosse machine : on met du gaz à effet de serre, ça chauffe. On en retire, ça refroidit. Dès lors, du moment que la civilisation humaine émet suffisamment de gaz à effet de serre pour dérégler le climat, c’est à elle, et à elle seule, de prendre les mesures nécessaires. Dieu ne nous soustrait pas aux responsabilités qu’il nous a rendus capables de gérer. La bonne gestion de la Terre en fait partie. Ne laissons donc pas une accusation de « manquer de foi », si culpabilisante au demeurant, nous soustraire à nos responsabilités humaines. Lutter contre le réchauffement climatique n’enlève en rien la confiance que nous plaçons chaque jour en Dieu pour toutes les dimensions de nos vies.
Source : Marc Roethlisberger et Steve Tanner, FAQ, Déclaration Urgence Climat Suisse.

Deux questions en une, Nicolas ! Pour répondre à la première, effectivement la chronologie biblique prise à la lettre tomberait en flagrante contradiction avec ce que nous savons de l’âge de la Terre et de l’humanité. Le rédacteur du premier chapitre de la Bible n’avait pas nos connaissances scientifiques, mais son message est vrai, inspiré, pertinent : le monde n’est pas éternel, tout a un commencement (contre la vision païenne, antique, d’un univers statique, d’un temps circulaire…). Rien n’y est donc divin ou sacré, ni lune ni soleil ni étoiles. Ce sont des créatures, comme nous le sommes aussi. Genèse ch.2 compare le monde à un jardin à cultiver et à garder. C’est une image, mais qui n’est pas sans résonance dans nos préoccupations écologiques d’aujourd’hui. Adam et Eve ne sont pas, pour leur part, à identifier à Lucy, à l’australopithèque ou autres hominidés, mais aux humains à qui Dieu s’est révélé, ce qui justement a fondé leur statut d’êtres créés à son image.
Bref, il ne faut pas confondre (ni opposer d’ailleurs) le récit biblique avec un exposé scientifique des débuts de l’univers ou de l’histoire de l’Homme. Ce sont des genres différents, écrits l’un pour décrire, dire le « comment », l’autre expliquer, donner une réponse au « pourquoi la vie ? pourquoi le monde ? » etc.
Il faut garder en tête cette distinction en abordant la question de la mort, et cette mise en garde de Dieu à l’homme en Genèse 2,17 : « le jour où tu mangeras de ce fruit que je t’interdis, tu mourras ». Voici comment nous pouvons la comprendre. L’homme n’a pas été créé comme possédant l’immortalité, dans la mesure où, simple créature, nue et fragile, il ne vit que du souffle de Dieu. Il n’a pas davantage été « programmé » par Dieu pour mourir et retourner au néant. Mais en se séparant de son Créateur, il se sépare de ce qui le fait vivre un peu comme un scaphandrier couperait son tuyau d’alimentation en oxygène. Notez que sitôt mangé le fruit, l’homme et la femme éprouvent la honte de leur nudité, c’est à dire de leur statut de créature limitée, faible. Ils ont voulu se prendre pour des dieux, ils découvrent qu’ils sont poussière. « j’ai eu peur (de toi, dit Adam à Dieu qui le cherche), parce que j’étais nu, et je me suis caché » Genèse 3,10. Il y a mort et mort ! La mort, dans la Bible, ce n’est pas seulement l’arrêt des fonctions biologiques, c’est être privé de la présence de Dieu.

Je crois que Dieu a doté l’être humain d’une raison, d’une capacité de réflexion, ainsi que d’une curiosité qui peuvent l’amener à se mettre en quête de nombreux domaines de découvertes. Tant qu’il s’agit de mieux s’émerveiller devant la grandeur de la création et donc devant la majesté du créateur, tant qu’il s’agit de développer chez soi le sens de la responsabilité à l’égard de cette création pour laquelle le créateur nous appelle à une domination à son image, je crois qu’il faut même encourager ces explorations (dans l’espace autant que dans l’infiniment petit, dans le ciel comme au fond des océans). Mais si ces recherches sont mues par l’avidité ou la cupidité (trouver toujours de nouveaux gisements d’hydrocarbures, de nouvelles substances pour produire des biens de consommation…) ou par l’orgueil, alors, comme toute autre attitude humaine stimulée par de telles motivations, elles ne correspondent plus à la volonté de Dieu pour nous.